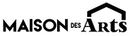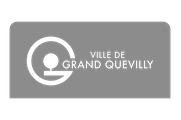Sans titre
Membre de l’Union des arts plastiques de Saint Etienne du Rouvray, il dit de sa peinture qu’elle est née de son insatiable curiosité pour la vie et son énergie. Ses toiles sont construites avec des formes colorées qui se jouxtent, se croisent, se superposent, restituant le mouvement perpétuel de la vie.