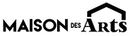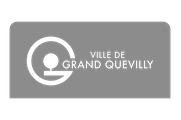Songeuse
En 1987, elle termine la Faculté d’Art Graphique de l’Institut National Pédagogique de St Pétersbourg et organise sa première exposition personnelle dans le jardin d’hiver de cette ville. Elle devient membre du Groupement des Artistes Peintres SOVART et continue à exposer ses tableaux Russie, Pologne, Finlande, Ukraine. Depuis 2003, elle vit en France, et participe à divers salons artistiques régionaux